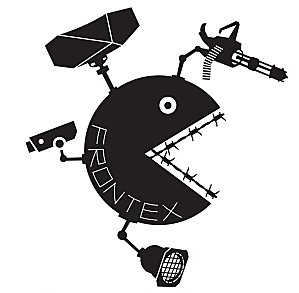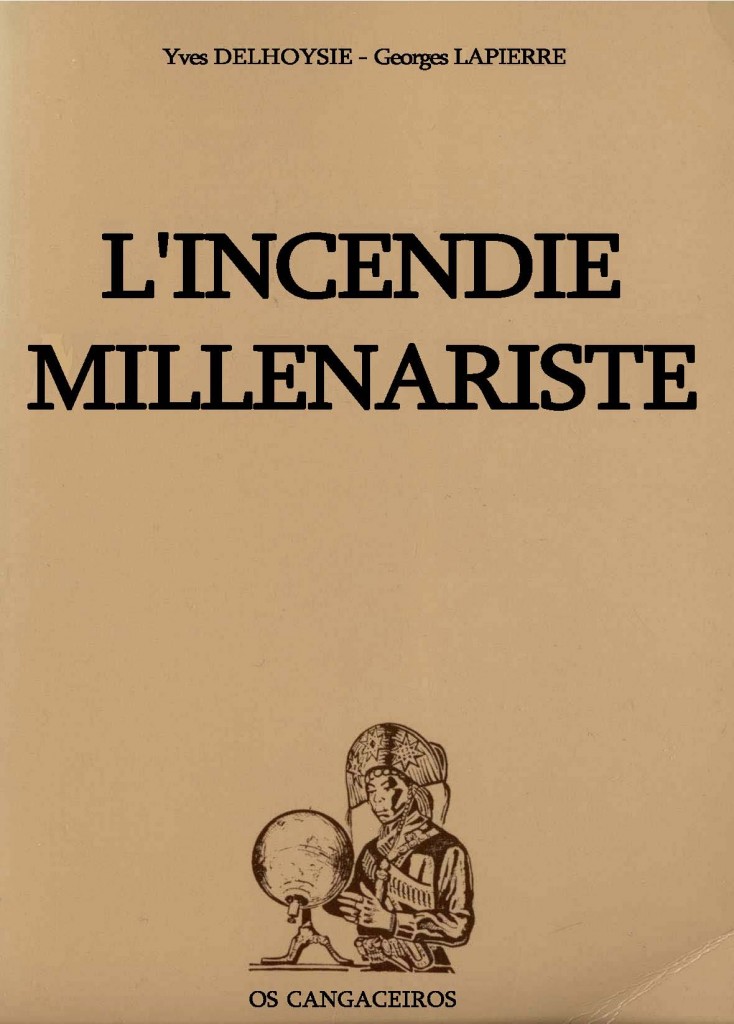[3 textes retrouvés, repris par la base de données anarchistes, disponible aussi sous la forme d’un 4 pages.]

Après la grève
Des lendemains qui déchantent
Depuis la dernière grande grève à la SNCF, en 1995, nous assistons, dans les milieux à l’extrême gauche de la gauche officielle, à la énième tentative de réchauffer le cadavre du militantisme, via la multiplication d’interventions qui finissent, l’enthousiasme initial retombé et l’illusion de rencontre vaporisée, par des désillusions, mais sans que le moindre bilan critique n’en soit tiré. Dans les cénacles de la militance en question continue à régner le mythe, qui a déjà fait faillite mille fois, selon lequel il est possible, à condition de faire preuve d’imagination, de ténacité, de ruse, de souplesse, etc., de surmonter les séparations qui traversent et divisent l’univers des damnés de la Terre. La démarche de Cargo en est sans doute le meilleur exemple.
A la base de pareilles tentatives, il y a la profonde incompréhension de la nature de la société capitaliste. Désigner le pouvoir d’Etat comme la source principale de tous les maux et le démiurge de toutes les séparations, c’est évoluer, mine de rien, dans les limites de l’idéologie républicaine. Bien entendu, le pouvoir en assure la gestion, mais, en dernière analyse, les séparations sont partie intégrante de la société capitaliste moderne, à la fois source de la dislocation de communautés traditionnelles – comme les communautés ouvrières –, d’atomisation des individus – médiatisés par la communauté de la marchandise – et aussi cause de reconstitution de communautés de substitution : religieuses, patriarcales, etc. Tant que les individus agissent comme membres des communautés en question, ils peuvent être hostiles à ce qui leur apparaît comme étranger à leurs références communautaires obligées – le pouvoir d’Etat actuel au premier chef –, mais leurs convergences ne prennent corps que là où ils s’affirment en tant que tels : des individus, certes possédant leur propre histoire individuelle et sociale, mais capables de ne pas en rester là. Dans le cas contraire, ils n’ont bien souvent de pires ennemis qu’eux-mêmes et leurs identités communautaires, plus ou moins imaginaires, jouent le rôle d’entraves à la création de relations et d’activités librement choisies. La désignation et la reconnaissance de l’existence de l’ennemi officiel commun n’y changent rien. Sinon, la subversion du capital aurait été réalisée depuis longtemps.
Même la communauté de condition sur laquelle repose la domination moderne, la réduction des êtres humains au rôle de salariés générant le capital, n’est pas en elle-même source de rencontres et d’affinités subversives. Ce n’est pas en rabâchant aux premiers concernés, à l’image des syndicalistes de base, que les maîtres vivent en parasites sur le fruit du travail des esclaves, qu’il est possible de contribuer à débloquer la situation. Car les prolétaires salariés ne travaillent pas exclusivement pour les propriétaires et les gestionnaires de la domination, mais aussi pour eux-mêmes, au titre de membres de la société capitaliste. Ils n’y sont pas étrangers, même lorsqu’ils ne sont pas reconnus comme tels, par exemple les salariés sans papiers. Leur travail est bien la source principalede leur revenu, direct et indirect par le biais de l’Etat. C’est la raison principale pour laquelle ils y tiennent et, à ce titre, le défende et demandent qu’il soit reconnu comme tel, lorsque ce n’est pas le cas. Là est l’origine de l’esprit syndicalisme qui perdure et grâce auquel les institutions syndicales, même affaiblies par la modification de la structure de classe de la société et parfois malmenées par des prolétaires en colère, perdurent, au point que leur fin, maintes fois prophétisée, n’est pas au rendez-vous fixé par des « révolutionnaires » à très courte vue. En d’autres termes, le travail salarié, comme mode d’activité et de relation propre au capitalisme, a pour conséquence de faire accéder la masse des prolétaires au monde de la marchandise, de façon plus ou moins différenciée et avec plus ou moins de bonheur en fonction des périodes historiques. Certes, aujourd’hui moins qu’hier. Personne ne le nie.
De même, dans de tels milieux « révolutionnaires », la dénonciation du recul de la protection sociale accordée par l’Etat est aux antipodes de la réalité. Sans même en avoir conscience, les animateurs de Cargo, par exemple, reprennent à leur compte la représentation de l’Etat providence qui est celle des apologistes de l’école néolibérale honnie. A savoir que l’institution en question reposerait sur les bonnes oeuvres du capital, à titre de généralisation de celles de l’Eglise au Moyen Age. Or, les mesures prises par l’Etat providence n’ont jamais relevé, pour l’essentiel, du système d’assistance à l’indigence, assuré, dans l’histoire de l’Europe, par les administrateurs de la monarchie absolutiste, par ceux des congrégations religieuses, etc. Le terme de « providence », d’origine chrétienne, cache la gestion par l’Etat moderne de la socialisation du salaire, sur la base du compromis fordiste, à l’époque de l’accélération rapide de la production et de la consommation de masse, mode de gestion dont les limites apparaissent de plus en plus clairement aujourd’hui. Limites relevées depuis longtemps par les ouvriers de l’industrie « bénéficiaires » du système issu, en France, de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, ils surnommaient parfois, dans les années 70, leur système de retraite hiérarchisé la « retraite de la veuve » tant ils étaient conscients, malgré leurs illusions sur le rôle de l’Etat, que, après plus de quarante ans passés dans les bagnes industriels, le cercueil les attendait à bref délai, pas le farniente dans l’insouciance, et encore moins le bronzage sur quelque île exotique du Club Med. Par suite, le reproche essentiel à faire à l’Etat providence, ce n’est pas d’avoir accordé des privilèges, comme l’affirment les curés marxistes-léninistes, qui noyautent les comités de sans-papiers dans la région parisienne, mais d’avoir accru la dépendance des individus envers l’Etat et le capitalisme en général, et donc d’avoir rendu plus difficile la constitution de forces subversives.
Bien sûr, des actes de résistance, individuels et collectifs, et donc des rencontres restent possibles. Mais elles sont, en règle générale, éphémères et sporadiques et n’impliquent que des poignées d’individus. Ce n’est pas négligeable, mais il est nécessaire d’en finir avec l’illusion que de vastes et durables complicités peuvent apparaître ainsi, sur le terrain exclusif de la résistance à l’évolution actuelle du monde. Surtout, lorsque, au prétexte de ne pas briser l’unité apparente des collectifs de résistance, les milieux « révolutionnaires » ferment les yeux sur les contradictions criantes qui apparaissent en leur sein, et même sur des préjugés, des attitudes, des poses, etc. qu’ils sont censés, eux, ne pas accepter. Quant à nos interventions à partir de situations qui ne sont pas dues à nos propres initiatives, reconnaissons que, même lorsqu’elles ont du sens, elles ne changent pas grand-chose au cours général des choses. Dans le cas contraire, des affinités seraient déjà apparues dans des paroles et dans des actes débordant les cercles de convaincus.
Comme affirmé en préambule, même la désignation de l’ennemi commun officiel, en premier lieu le pouvoir d’Etat, n’indique pas que les motifs de ses divers adversaires puissent être convergents, absence de convergence qui ramène presque à zéro les possibilités de reconnaissance mutuelle et de rencontre effectives. Ce qui dépasse la question, habituellement mal posée, des revendications, et même de leur absence, dans laquelle des « révolutionnaires » bien étrangers aux combats réels des dernières décennies en Europe, croit déceler quelque transcroissance de l’idéologie revendicative. Vision pour le moins simpliste car, même en l’absence de revendications, les motifs peuvent être divergents, voire antagoniques, au point que la reconnaissance de l’ennemi commun n’empêche pas les protagonistes d’être ennemis entre eux et de le faire savoir, y compris pas des actes de violence relevant de la guerre de tous contre tous, parfois au grand dam des « révolutionnaires » qui, face à l’unanimité de façade initiale, avaient cru que les séparations de ce monde étaient en passe d’être dépassées. En réalité, la conception qui domine dans les milieux « révolutionnaires » est de type utilitariste, et elle n’outrepasse pas le cadre de la morale des besoins et des intérêts.
Cela n’implique pas de négliger les desiderata des premiers concernés, en introduisant, a priori, des séparations entre des exigences particulières et le désir de bouleverser en totalité le monde. Dans la réalité, nous savons que les situations sont souvent plus complexes qu’il n’y paraît à première vue et qu’elles engendrent parfois des processus de rupture aussi imprévus que prometteurs. Mais il faut arrêter de raisonner comme si la domination était encore quelque chose de réductible à l’institution du même nom, de facile à cerner sous la figure de ses dépositaires officiels, bref d’essentiellement extérieure aux individus alors qu’ils l’ont intériorisée depuis longtemps, sous des formes souvent difficilement détectables, qui ne prennent pas toujours l’aspect de lois, de normes, etc., reconnues comme telles. A trop personnaliser et caricaturer la domination, nous risquons de perdre de vue la totalité des relations qui la constituent et donc à jouer le rôle de claque turbulente, mais de claque quand même, de ce que nous prétendons combattre.
Année 1996
_______________________
A propos du collectif Cargo
Du contrôle comme roue de secours des radicaux parisiens
Lorsque l’on écoute parler bon nombre d’individus qui prétendent être en rupture avec le discours de la domination, on ne peut qu’être surpris par la contradiction qui transparaît à travers leurs propos. A première vue, ils n’ont pas de mots assez durs pour stigmatiser les anciens programmes révolutionnaires. Pourtant, le rejet n’implique pas toujours le dépassement et camoufle alors le recyclage des pires tares desdits programmes. Comme quoi, les célèbres idéologues barbus d’autrefois ont beau avoir été enterrés par l’histoire officielle, leurs fantômes n’en continuent pas moins à hanter les têtes, parfois très jeunes, de bon nombre de présumés radicaux. Evidemment, sans que la plupart d’entre eux aient la moindre idée de l’origine des conceptions antédiluviennes qu’ils avancent comme autant de nouveautés, susceptibles de modifier quelque peu la funeste situation de régression dans laquelle nous nous trouvons en France, que même les grandes grèves dans les services d’Etat, comme celle à la SNCF, ne réussissent pas à endiguer. Au plus, la prétendue gauche de la gauche officielle réalise l’amalgame entre vieilles et nouvelles idéologies, formulées à l’université par les gourous de la « révolution moléculaire », dans le genre de Deleuze, autour du concept de « substitution de la société de contrôle à la société disciplinaire ».
Les discussions animées par le collectif Cargo autour du thème « travail salarié, contrôle social et revenu garanti » en sont la preuve. La façon dont il adapte au goût du jour les idées éculées du programme de transition de Trotski laisse pantois. Rappelons, pour ceux qui n’en connaissent pas la genèse, les conditions d’apparition. A la fin des années 30, alors que le fascisme triomphait et que la menace de guerre était de plus en plus précise, Trotski fut confronté, comme tous les leaders communistes, à la déconfiture quasi-totale des organisations de masse qu’ils étaient censés diriger. D’où la question : comment recommencer à rassembler les masses défaites, atomisées et dispersées, pour préparer la révolution alors que, justement, elles ne veulent plus en entendre parler ? La réponse fut le programme de transition. Trotski chercha à détecter alors ce qui constitue en quelque sorte l’essence de la situation qui pèse sur les masses et à formuler, à partir de là, des revendications transitoires qui, à condition qu’elles les réalisent, sont susceptibles de les remettre dans le bon chemin. A l’époque, il voit dans la coercition d’Etat de type fasciste et dans les préparatifs de guerre les deux facteurs essentiels à partir desquels développer la conscience et l’organisation des masses. En théorie, c’était de la métaphysique de la pire espèce, de celle qui oublie carrément la totalité de l’histoire et du contexte sous prétexte d’en dégager « l’essence », représentée en réalité par des parties détachées de façon artificielle de l’ensemble. En pratique, c’était de la politicaillerie, marquée par la recherche permanente d’alliances avec tel ou tel parti. Le programme de transition, de toute façon, ne donna rien pour la bonne et unique raison qu’aucun idéologue, même le plus « malin », ne peut « ruser » avec l’histoire et stimuler les masses lorsqu’elles ne peuvent plus et ne veulent plus bouger.
Avec leur proposition de « revenu garanti », les apôtres de Cargo marchent sur les traces de Trotski, dans des conditions qui rappellent, en partie celles des « années sans pardon », pour reprendre l’expression de Victor Serge. Nous aussi, nous sommes confrontés à la défaite, durable et profonde, à mon avis, de l’ensemble des tendances révolutionnaires qui marquèrent de leur sceau la vie de l’Europe pendant plus de dix ans. Mais avec de notables différences. La coercition d’Etat prend des formes moins brutales qu’autrefois, du moins au quotidien. L’atomisation et la subordination aux impératifs de l’économie et de l’Etat repose désormais aussi sur la modification en profondeur de l’ensemble de la structure de la société qui résulte de la défaite et, en même temps, l’aggrave. Parmi les traits essentiels de la modification en cours, citons la perte de centralité du travail matériel au bénéfice du travail immatériel, et même la place grandissante du non-travail, ainsi que la réduction du rôle des prolétaires comme facteur de transformation révolutionnaire et le recul accéléré de leur communauté de classe au bénéfice de l’atomisation citoyenne et des communautarismes les plus divers. Dans de telles conditions, il est très facile de réduire le travail à la dimension signalée par Nietzsche, « le travail comme meilleure des polices », et donc d’appréhender la relation salariale comme simple distribution de revenu, à la mode de Keynes. De là découle, dans la pure tradition des chefs à la recherche de troupes, la revendication du « revenu garanti », moyen privilégié pour, à la fois, maintenir le niveau de revenus de l’ensemble des individus atomisés et les unir, sous l’égide de l’Etat, « contrôlé par la société civile », c’est-à-dire les associations civiles comme Cargo ! Dernière tentative de participer à la gestion de l’Etat providence en pleine déconfiture !
Reste à savoir pourquoi, à Paris, bon nombre de « révolutionnaires » qui rejettent les propositions « transitoires » des gourous de Cargo tiennent des propos aussi réductionnistes que les leurs sur le rôle du « contrôle » et sur les possibilités d’unification qu’il offre comme terrain de lutte commun pour rassembler, sinon les plus larges masses – personne n’y croit plus, excepté le dernier carré des plus furieux marxistes-léninistes parisiens –, du moins les fractions les plus radicales d’entre elles, ou, de façon encore plus minimaliste, pour rapprocher les clans dispersés de la scène radicale parisienne. Evidemment, Negri et les autres rédacteurs de Futur antérieur jouent leur rôle néfaste en offrant, aux esprits désorientés à la recherche de fil directeur, leur kit « post-opéraïste ». A la suite de Deleuze, le professeur de Padoue répète, à longueur de pages, que la « métropole parisienne » n’est plus, pour l’essentiel que le « bassin du travail immatériel » et le « laboratoire du contrôle métropolitain ». Dans la tradition de la sociologie expérimentale, prisée dans les milieux universitaires parisiens, Negri transforme ainsi les lieux de pouvoir réels en laboratoires en plein air du « pouvoir virtuel ». Dans cette optique, l’essentiel, c’est la représentation de la chose, pas la chose elle-même. Mais il y a d’autres facteurs qui entrent en ligne de compte pour comprendre le rôle démesuré accordé à Paris au « contrôle ». A commencer par la structure actuelle de la mégapole parisienne et les travers bien connus des radicaux parisiens, qui, dans leur âme modeste, croient toujours être en tête des initiatives théoriques et pratiques. De tels travers sont encore aggravés par la destruction accélérée du Paris populaire et les rendent encore plus impopulaires dans les provinces. « Si Paris, par suite de la centralisation politique, domine la France, les ouvriers dominent Paris dans les moments de séismes révolutionnaires. » Il y a belle lurette que la célèbre phrase de Marx dans Les luttes de classe en France, en 1848, ne correspond plus à rien et relève de la mythologie. Désormais, bien plus qu’à la centralisation traditionnelle de l’Etat, on assiste à Paris à la concentration spectaculaire du pouvoir d’Etat, sur fond de crise du modèle d’Etat-nation à la française et de globalisation accélérée du capital. Ce qui diminue d’autant le pouvoir décisionnel dévolu jusqu’alors aux institutions d’Etat domiciliées à Paris. En d’autres termes, Paris devient de plus en plus la capitale de la représentation du capital, en particulier de la représentation policière, et de moins en moins le lieu privilégié où des forces subversives puissent apparaître de façon conséquente. A Paris les « révolutionnaires » sont non seulement « en manque de révolution », ce qui n’est pas propre à la capitale, mais encore bien plus suspendus dans le vide qu’ailleurs, ce qui favorise le perte du sens du réel. En dernière analyse, il ne leur reste en commun que le poids du « contrôle ». Ce qui les amène à négliger, comme quelque chose de secondaire, l’ensemble des formes d’exploitation et de domination qui pèse sur les damnés de la Terre, dans la capitale et ailleurs. Enfin, lorsque joue le dernier facteur – l’idéologie d’origine surréaliste et situationniste d’après laquelle les formes de représentation du pouvoir les plus avancées, et les plus avariées, sont concentrées à Paris et d’après laquelle la tâche des révolutionnaires est en priorité de combattre ces formes, pour jouer leur rôle d’éclaireurs dans la critique de la représentation –, on dispose de tous les ingrédientsn de base qui rendent les recettes de la tribu parisienne si savoureuses. De telles paroles peuvent paraître trop dures. Mais les révolutionnaires parisiens doivent comprendre qu’ils ne constituent pas le nombril du monde et qu’ils doivent faire au moins preuve de curiosité et de compréhension envers ce que existe ailleurs sous peine d’aggraver leur tendance à l’autisme et leur atomisation.
Année 1996
_______________________
Des papiers pour tous
Dernier avatar de la citoyenneté à la française
De nouveau, le collectif Cargo est revenu à la charge, bien que nous ayons été très clair, il y a quelque mois, sur leur marotte, le « Revenu garanti pour tous », lorsqu’ils firent leur numéro à la Bonne Descente. Désormais, dans la foulée de l’occupation de l’église Saint Bernard, ils présentent la revendication « Des papiers pour tous » comme la dernière panacée en date, susceptible d’exprimer et de faciliter la coagulation des forces de tous les étrangers en situation irrégulière en France et, même, de les amener à rompre avec les médiateurs qui tentent de les amener à accepter le « cas par cas ». Et, de nouveau, elle est justifiée par des considérations de type négriste. Lesquelles puent le léniniste recyclé, qui transparaît dans les prises de position du professeur de Padoue et dans celles de tous ses adeptes, en particulier des professeurs de Paris VIII, pour quiconque a quelque peu l’esprit critique.
Cargo ne manque pas d’air, en affirmant que la revendication « Des papiers pour tous » est née par génération spontanée au sein même du premier collectif d’occupation de l’église Saint-Bernard. En réalité, pour quiconque a suivi l’affaire de près, il est facile de voir qu’elle a été concoctée dans les officines situées à gauche de la gauche officielle et qui militent, entre autres choses, pour ouvrir davantage l’éventail de l’activité syndicale, au-delà des portes des dernières concentrations ouvrières en France et du corporatisme obsolète façon CGT. SUD en est la préfiguration et c’est pourquoi bon nombre de ses leaders, qui portent parfois aussi les multiples casquettes de prétendus délégués des diverses associations de « sans », sont particulièrement investis dans les collectifs de « sans papiers ». Pour racoler du côté de Saint Bernard, de telles officines se sont alliées à des curés, apôtres de l’église des pauvres relookée citoyenneté planétaire, style Gaillot, sans compter des sectes aussi dégueulasses que le parti marxiste-léniniste du Sénégal, aujourd’hui ripoliné en lobby citoyen, en pointe dans la défense et la propagation de la « revendication unitaire », et dont les chefs jouent le rôle de modestes immigrés en colère, tels que l’idole des médiateurs et des souteneurs en tous genres : la pasionaria caméléon Madjiguène Cissé.
Bien entendu, « Des papiers pour tous » rencontre l’adhésion de la grande masse des « sans papiers » et il n’est évidemment pas question d’accepter le « cas par cas ». Bon nombre d’entre eux la reprennent à leur compte – dans les assemblées où nous sommes allés, elle était votée sur proposition de leurs délégués, en réalité des délégués du parti marxiste-léniniste sénégalais, par exemple, belle preuve de spontanéité ! – car elle semblait correspondre à leur besoin de rassembler leurs forces face à l’Etat, de sortir de la clandestinité qui leur est imposée et de bénéficier des « faveurs » que l’Etat providence à la française aurait accordé depuis des décennies à toutes les personnes d’origine étrangère résidant dans l’Hexagone. C’est bien connu, la France est la Jérusalem de l’esprit républicain universel, le siège du temple déiste de Robespierre où les vestales entretiennent la flamme des dieux de l’Etat moderne, à commencer par Rousseau.
Par suite, on comprend que l’exigence, à première vue légitime et unificatrice de « papiers pour tous », repose en réalité sur l’incompréhension de la nature de l’Etat républicain en France. Ce que les « sans papiers » imaginent être la réalité de la vie dans l’Hexagone, au moins depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, et ce que les hérauts de la démocratie leur présentent comme leurs droits inaliénables, n’a jamais existé. Même dans l’Etat sanctifié comme le « berceau de la liberté », pas de « droits » sans « devoirs », et c’est bien entendu les nécessités de l’économie et du pouvoir d’Etat, dans telle ou telle période de l’histoire, qui les déterminent et nullement de prétendus principes éternels, qui n’en sont que la représentation aliénée.
En France, le premier « droit de l’homme » – notons bien, pas seulement premier « droit du citoyen » –, inscrit au fronton de la Constitution depuis 1945, c’est le « droit au travail », qui n’est en réalité que le revers du « devoir de travail », en d’autres termes de la nécessité de travailler même si, dans la société capitaliste, elle ne prend pas nécessairement la forme de l’obligation de le faire en permanence comme dans les systèmes de domination antérieurs, voire à des périodes antérieures de la société capitaliste, à l’époque de l’accumulation initiale en Angleterre, par exemple. Au cours des Trente Glorieuses, si l’immense majorité des résidents étrangers dans l’Hexagone avait « droit » à des « papiers », c’était essentiellement parce que le capitalisme hexagonal, après la saignée de la dernière guerre mondiale et la reprise de l’accumulation forcenée de capital à la mode fordiste, en avait besoin à titre de travailleurs salariés dans les immenses concentrations industrielles qu’il développait. Tel était leur « devoir » et il faut être imprégné de préjugés républicains de la tête aux pieds pour oublier l’histoire récente de l’Etat et présenter les choses comme s’ils avaient bénéficié de « droits » sans « devoirs ». Sans « travail pour tous », il n’y aurait pas eu de « papier pour tous », comme le montre l’histoire des apatrides en France à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
De plus, en assemblées, les hérauts des « droits de l’homme » affirment parfois, que, même au cours des Trente Glorieuses, les immigrés n’étaient pas traités comme des « hommes », contrairement au préambule de la Constitution. Pour preuve, ils avancent le fait qu’ils n’avaient pas le « droit de voter ». Mais, depuis que la question du vote des immigrés est posée, en gros depuis Mai 68, le pouvoir d’Etat répond qu’il n’y a là aucun viol de la Constitution et qu’il ne faut pas confondre deux choses, Etat nation et Etat providence dont la protection n’est pas de nature territoriale, mais sociale, bien que la seconde soit liée à la première dans la mesure où elle n’est applicable que dans le cadre de la souveraineté hexagonale. Par suite, il n’est pas tenu de leur accorder de telles choses, ce qui reviendrait à les considérer a priori comme des citoyens français, ce qu’ils ne sont pas. Par contre, il confirme qu’ils doivent jouir des « droits de l’homme », tels que définis par la Constitution, c’est-à-dire des « droit de grève », « droit à la santé », « droit à la retraite », etc., découlant de leur statut de travailleurs reconnus comme tels par le pouvoir d’Etat.
Du côté des démocrates, la confusion entre droits politiques et droits sociaux est donc totale et la grande question du travail, tel qu’il évolue depuis des décennies, est escamotée. Par suite, la question de l’immigration « sans papiers » est impossible à poser, y compris auprès des premiers concernés, sans la relier à celle du travail, de son caractère de plus en plus inessentiel, comme nous l’avons souligné à de multiples reprises, dans le processus de valorisation du capital. L’Etat ne refuse des « papiers » à des masses croissantes d’immigrés parce que le capital aurait essentiellement besoin de les exploiter plus dans les limites du territoire national, comme l’affirment les pleureuses démocrates et tous les contestataires du prétendu néolibéralisme. La chose existe mais elle est marginale. C’est l’accélération de la globalisation du marché et l’automatisation inouïe atteinte aujourd’hui dans le processus du travail qui font que le capital, du moins dans les centres décisifs de l’économie, a de moins en moins besoin d’eux. Ce qui annonce la fin probable de l’organisation fordiste du travail et le recentrage de l’Etat autour de fonctions plus régaliennes.
En la matière, notre activité ne peut pas consister à formuler des revendications, aussi générales et unitaires qu’elles paraissent, à la place de ceux et de celles qui entrent en lutte effectivement. Pas plus qu’à faire de la surenchère en reprenant et en propageant sans le moindre recul celles qui semblent outrepasser l’idéologie néolibérale, par exemple « Des papiers pour tous » à la place du « cas par cas ». Par contre, nous pouvons apporter notre contribution, en affirmant notre position, par la plume et par d’autres moyens en fonction des conditions réelles auxquelles nous sommes confrontées, sans jamais faire le moindre cadeau aux illusions et aux groupes qui participent à ramener les moindres manifestations d’insubordination des « sans papiers » dans le giron de l’Etat.
Année 1997
Pour obtenir ces trois notes, rédigées après des discussions collectives effectuées autour de La Bonne Descente, à Paris, au milieu des années 90, écrire à l’adresse : julius93@free.fr