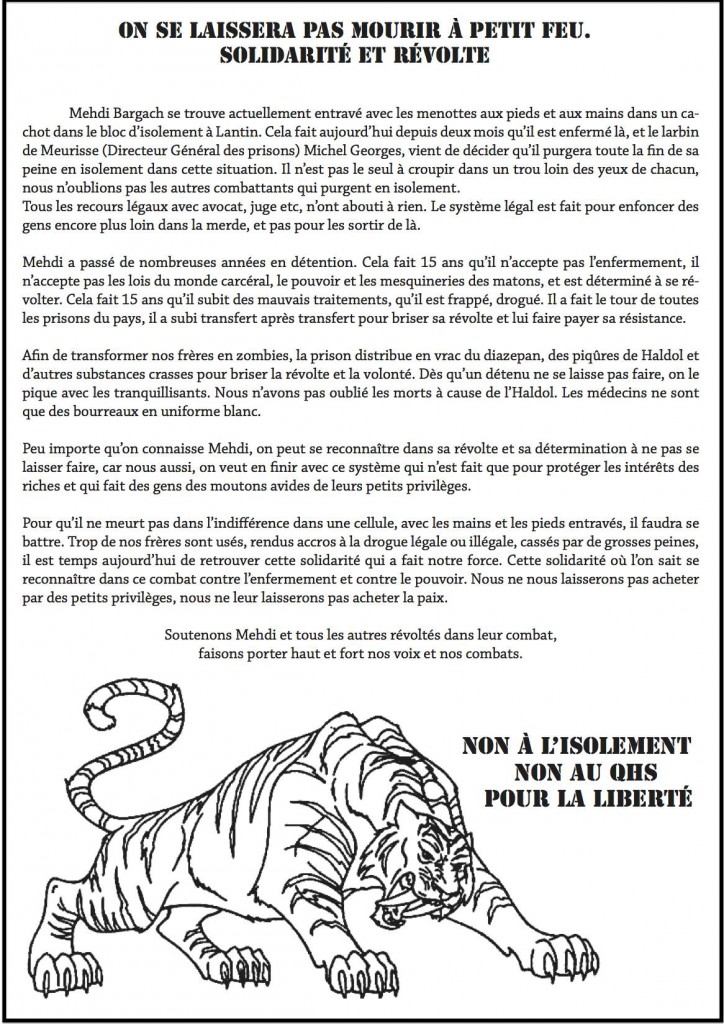Christine était précédemment incarcérée au Centre de Détention de Bapaume. Depuis le 5 juillet elle était au mitard pour avoir voulu manger sa gamelle en promenade avec une amie codétenue (voir ici à ce propos).
Fin juillet, une autre détenue est placée au mitard dans la cellule à côté de Christine. Celle-ci est violentée par les matons et peine à avoir un entretien avec un médecin. Christine décide alors de refuser de remonter de promenade en solidarité avec sa voisine de cellule. Aucun résultat. Les matons ne répondent alors plus à ses appels incessants à l’interphone. Pour les faire se bouger, elle leur dit alors « il va y avoir de la prise d’otage dans l’air ». Rapidement matons et toubib viennent voir sa voisine, mais le toubib refuse d’entrer dans la cellule, puis s’apprête à repartir sans aucune consultation. Christine l’interpelle en lui disant de ne pas partir car elle avait dit qu’elle ferait une prise d’otage. Ni une ni deux, elle est renvoyée en cellule par une dizaine de matons. Quelques heures plus tard, on vient la chercher pour la transférer à Lille-Sequedin.
Arrivée là-bas, une note interne interdit au personnel soignant de rencontrer Christine sans la présence des matons. Ces derniers s’y plient. Christine se lance alors de nouveau dans un bras de fer, cette fois-ci pour elle-même avoir droit à une consultation médicale. Refus de remonter de promenade, incendies de poubelles, rien n’y fait et le niveau de violence que les matons donnent en réponse ne cesse de grimper. Christine décide alors de faire une grève de la faim et de la parole. Ils l’ignorent ou tentent de l’en dissuader, mais Christine tient bon. L’OIP de Lille est réactif et somme l’Administration Pénitentiaire et le service médical (UCSA) de s’expliquer sur la situation.
Le lendemain, au bout de huit jours de grève de la faim, Christine obtient satisfaction vis à vis de ses revendications (consultations permettant le secret médical, coup de fil à son avocate et entretien avec la direction).
Le 16 août, les 45 jours de mitard écoulés (15+30 avec une pause de quelques jours. Maximum 30 jours de mitard consécutifs depuis une réforme de 2009) elle sort mais est placée directement en Quartier d’Isolement (QI).
Cela ne durera qu’une semaine. Le 22 août, elle est de nouveau placée au mitard. Cette fois-ci pour avoir fait valser un vélo après s’être vu refuser de passer l’heure de sport avec sa voisine de QI.
Elle passera lundi 26 août en commission de discipline pour ces faits mais également pour « violences aggravées » contre des matons (au moment de son bras de fer pour voir le toubib). Ils se seraient blessés en cognant Christine… Ils ont également porté plainte.
Le jeudi 19 septembre à 13h30, aura lieu le report de son procès au TGI d’Arras (place des États Artois).
Soyons nombreux ce jour là !
Pour lui écrire :
Christine RIBAILLY, écrou 24192, MAF – QD, BP179, 59482 SEQUEDIN cedex
Ci-dessous, des extraits de lettres de Christine relatant les derniers événements.
SEQUEDIN,
dimanche 28 juillet
Bon ben, j’ai encore changé d’adresse. […] Me voilà à Lille, de là Redoine Faïd est arrivé à mettre les voiles. Comme je n’ai pas son réseau, je pense pas pouvoir sortir du Quartier Disciplinaire [QD/mitard] avant le 20 août et d’ici avant le 20 septembre, après le procès d’Arras.
Pour résumer l’histoire, […]mercredi ils ont amené K. une fille que je connais à peine, avec l’équipement anti-émeute que je me croyais réservé. Elle était super énervée, même quand ils sont partis. Elle gueulait toute seule à coup de « j’m’en fous », « bande de salopes », « j’vais aller à l’hosto » et tapait sa fenêtre comme une sourde. Elle ne me répondait pas et les a envoyés chier quand ils ont ramené la gamelle.
Mais enfin, vers 3h, elle a eu une demande claire : elle voulait aller au téléphone pour appeler SOS amitié (n° gratuit). Ça aurait été le moyen qu’elle discute, mais ils ont botté en touche à coup de « on verra plus tard ». Moi même j’étais assez énervée par le bruit qu’elle faisait et par le retard du courrier (distribué normalement à midi). Bref, elle a bouché les chiottes et a déclenché la chasse d’eau une centaine de fois. Au bout d’une demi heure, le QD (nos 2 cellules et le couloir) était noyé. Quand je leur ai dit à l’interphone, d’un seul coup, ils ont été disponibles. Ils m’ont collée en promenade avec mon courrier et ont nettoyé ma cellule. Mais elle, ils ne lui ont pas ouvert, ces cons ! Je leur ai dit ce que je pensais de leurs méthodes et ils m’ont répondu qu’elle avait les mêmes que moi (sauf que là il n’y a pas « dégradation par moyen dangereux » comme avec le feu). À 17h30, quand ils m’ont ouvert pour rentrer, je leur ai dit que j’avais un devoir de solidarité et que je ne rentrerai pas tant que K. n’aura pas ses lunettes, son tabac, ses bouquins et les couvertures qu’ils étaient venus lui prendre avec les casqués à 16h. Ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire sans l’équipe alors je leur ai dit que j’attendrai dans la cour qu’elle arrive. Je pensais voir débarquer les casqués pour me remettre en cellule, mais ils ne sont revenus qu’à quatre dont le directeur Mathieu. Le chef du Quartier Femmes (QF), Wattel, m’a dit qu’il n’avait rien pu lui donner car elle était trop énervée. Comme je n’ai pas de raisons de le croire, j’ai crié pour appeler K. Mathieu m’a dit « vous parlerez mieux à la porte ». Je savais que c’était pour me faire rentrer mais j’ai accepté car j’espérais qu’elle serait d’accord pour m’écouter. Ils m’ont même ouvert la porte et j’ai tenté de lui parler à travers la grille. Mais elle était super énervée, criant et tapant la fenêtre, inaccessible à la moindre discussion, murée dans sa colère et sa douleur. Quand je lui ai dit qu’il fallait qu’elle pense aux bébés dans le bâtiment, elle a gueulé « le mien de bébé, il est au cimetière ! ». Je ne pouvais rien faire, j’en étais dégoûtée et j’ai accepté de rentrer dans ma cellule. Je savais qu’elle cherchait à aller en HP et ça me rendait très triste de la voir se détruire.
A 18h30, ils sont venus équipés pour la menotter et bien qu’ils en aient trop fait, elle n’a pas réagi violemment. En fait, elle était contente d’être calmée de force et d’aller à l’hosto. Mathieu m’a confirmé que j’aurai le tél le lendemain avec ma famille. Vers 23h, ils l’ont ramenée et j’étais contente qu’elle ne soit pas en Hospitalisation d’Office. Mais ces salauds l’ont remise dans sa cellule pleine d’eau sale, sans couverture ni tabac. Je les ai suppliés de la mettre en cellule propre ou de me laisser passer la raclette mais rien à faire. C’est vrai qu’elle était assez calme à cause de la piqûre mais de m’entendre m’énerver l’a remontée. Et c’est reparti pour 1h de tapage au milieu de la nuit pour réveiller tout le bâtiment. Ce salaud de chef qui avait refusé de l’accueillir proprement est venu voir : il s’est fait envoyer paître. Puis, entre minuit et 1 heure, la fatigue l’a gagnée (et la piqûre) et elle s’est calmée. Moi j’ai peu dormi entre colère et tristesse.
Le lendemain, jeudi donc, j’ai expliqué dès 8h aux surveillantes qu’on ne pouvait pas la laisser comme ça, qu’il fallait au moins lui apporter un café chaud et que je lui passais du tabac. Elles ont compris, mais se sont réfugiées derrière le sempiternel « on ne peut rien faire sans l’ordre du chef… qui n’arrive qu’à 9h ». Alors, je leur ai mis 9h comme ultimatum. Mais à 9h, rien. Comme c’était plus calme depuis 5h du mat’ je lisais un récit d’un espagnol des années 80-90 qui racontait les revendications soutenues par des séquestrations de matons et les FIES [1] qui avaient suivi. Alors, j’ai dit à l’interphone : « vous vous en foutez hein quand on vous parle calmement . Eh ben venez avec vos boucliers pour la promenade, parce que il y a de la prise d’otage dans l’air ! ». Bien sûr, je n’avais aucun moyen de prendre qui que ce soit en otage : ils sont toujours plus nombreux que moi et je n’ai pas d’armes. Mais s’ils venaient équipés, ils n’auraient pas d’excuse de ne pas sortir K. le temps de nettoyer sa cellule. J’ai renouvelé la menace à 10h quand j’ai demandé quand était ma promenade à l’interphone et que la matonne a dit « ça sert à rien de crier » ; j’ai crié « non, ça sert à rien de crier, mais ça sert à rien non plus de parler, y’a qu’avec une prise d’otage que vous nous écouterez ! ».
A 10h30, ils sont venus à quatre, dont Wattel et la matonne avec qui j’avais discuté calmement à 8h, Mme Robert, et le toubib. K. l’a envoyé chier. Moi dans la cellule ouverte comme je lui ai appris, je l’ai engueulé de sa complicité face à la maltraitance que subissait K.. Il en a vite eu marre et est ressorti. Je l’ai suivi dans le couloir où étaient les bleus pour continuer à lui dire qu’on chopait des mycoses les pieds dans l’eau et qu’elle n’avait rien mangé depuis 24h. Quand il s’est approché de la porte pour sortir du QD, j’ai crié en faisant un pas en avant (j’étais au seuil de ma porte) « Eh toi, tu restes là ! J’ai dit que je faisais une prise d’otage ! ». La menace était ridicule et je n’avais touché personne, mais les 4 se sont rués sur moi et j’ai été coincée contre le mur. Je leur ai dit « calme, calme, je ne bouge pas » et la pression physique s’est relâchée mais ils avaient déclenché l’alarme. Quand la cavalerie est arrivée, je bloquais la grille assez facilement et ils étaient 4 à pousser et à se pousser dans le sas. Mme Robert était en première ligne car elle voulait calmer le truc. J’avais déjà accepté l’idée de ne pas aller en promenade, mais je voulais la promesse de Wattel que j’aurais le tél à 11h. La matonne était compressée par ses collègues et ça se voyait qu’elle avait mal. Quand Wattel a promis, j’ai retiré le pied et suis rentrée.
[…] Toute l’après-midi, j’ai appelé à l’interphone, toutes les demi-heure pour leur dire de venir avec le toubib, à chaque fois sans crier. J’ai crié pour dire aux filles du bâtiment ce qui se passait ici mais aucune n’a réagi.
Vers 15h15, ils ont enfin emmené K. à l’UCSA, sur un fauteuil roulant, menottée devant. Elle est revenue ¼ d’heure après, avec une ordonnance de radio, sans plus. Ils n’avaient toujours rien déposé dans sa cellule.
A 16h30, l’heure habituelle de ma promenade de l’après-midi, ils ne sont pas venus. J’étais super en colère mais n’ai rien fait. Dans l’après-midi, je les avais entendu bouger mes cartons dans la cellule à côté et j’avais pensé au transfert mais vu l’heure qui avançait, je me suis dit que je me faisais des films.
Vers 17h, les casqués sont arrivés, […] J’ai demandé si j’allais en garde à vue, si je devais prendre tabac et documents et il m’a dit que ça suivrait. C’est là que j’ai compris qu’on allait à la MA de Lille – Sequedin. Ils m’ont menottée dans le dos et je me suis laissée faire. J’ai quand même gueulé un « au revoir, les filles, je change d’air »
[…] Dans l’équipe du transfert, il y avait Bocquet [2] qui se régalait de me voir entravée, menottée dans le dos et en cellule. Il a continué à faire les gros bras devant ses collègues d’ici. À Bapaume, comme ailleurs, j’avais refusé la photo et la prise d’empreintes et c’était passé. Là, Bocquet m’a prise par la gorge et les cheveux contre le mur et je n’ai pu que fermer les yeux et ouvrir la gueule. Idem pour l’empreinte à force de torsion du poignet mais je ne crois pas qu’elle sera utilisable (« On n’aura pas mieux » ai-je entendu). Alors que j’avais accepté la fouille à nue à Bapaume, ils m’en ont fait une autre ici. Comme ils étaient nombreux et que des mecs, ils m’ont dit : « Tu te mets face au mur et tu ne te retourne pas. C’est bien compris ? Tu te désapes sans te retourner. C’est clair ? » J’ai obtempéré pour éviter la palpation mais j’ai obtenu mon tee-shirt avant de retirer le pantalon et n’ai pas tendu mes sandales qu’ils ont du ramasser eux-même. Puis traversée de la MA « libre » entre six matons d’ici, après avoir donné RDV à Bocquet le 19 septembre à Arras (en discutant avec ces potes d’ici, il a dit « Maintenant j’habite à 1km du taff »). […]
SEQUEDIN,
mardi 30 juillet
[…]Ce matin, vers 10h30, une autre toubib est venue. Comme son collègue, elle a refusée une consultation honnête. […] C’est la chef de détention (Sylvie ? Sophie ?) qui m’a ouvert pour la promenade à 14h30. […] Je lui ai redit, très calmement, que je ne rentrerai que lors de la visite médicale. J’avais un peu d’espoir car elle avait géré un conflit qui aurait pu dégénérer le dimanche, alors qu’une brigarde refusait que j’amène un livre en promenade (alors que c’était passé avec elle le vendredi et le samedi). J’avais dû bloquer la grille, heureusement sans blessé. Mais là, quand elle est revenue à 15h30 pour la fin de la promenade, elle avait déjà fait équiper 4 gars avec casques et boucliers. Ça a été l’assaut le plus violent de mon histoire pénitentiaire. Ils m’ont délibérément envoyée plusieurs coups de poings au visage pendant le menottage. Puis, ils m’ont cogné la tête dans chaque angle de murs sur le trajet du mitard. À Joux, l’arcade s’était ouverte et les avait immédiatement calmés. Mais là, elle a tenue. Ils m’ont dé-menottée sous le lit, en tordant doigts et poignets, comme d’habitude. […]
La douleur est presque passée, j’ai juste une gène au doigt tordu. Je sens une bosse au front, mais ne peux pas savoir si c’est devenu bleu.
Demain matin, c’est le jour de la douche. J’irai et bloquerai encore au retour s’il n’y a pas le toubib. Je n’ai maintenant plus d’espoir de respect, mais celui que la résine coule : ça les calme très vite et les fait appeler l’UCSA ou le 15.
SEQUEDIN,
samedi 3 août
Jusqu’ici, quand je m’affrontais à l’AP, je risquais des coups et du mitard, mais je pouvais m’appuyer sur la loi pour me garantir une certaine sécurité mentale. Là, il n’y a plus de garde-fous et ça me fait peur. C’est en partie de ma faute car j’ai entamé une grève de la faim, alors que je m’étais toujours opposée idéologiquement à ce mode d’action dangereux.
[…] Le mercredi matin, c’était le jour de douche et de retour de WE du chef de bâtiment. Il m’a demandé ce qu’il s’était passé et m’a dit de me préparer pour la douche et la promenade. Je lui ai répondu que j’étais tout à fait d’accord, mais que comme la veille, je ne rentrerai volontairement qu’après une visite médicale. Il est reparti puis est revenu avec un chef ++ (chemise bleue claire). Lui m’a dit que pour aller à la douche, je devais subir la fouille par palpation. J’en ai rigolé tant c’était ridicule : la douche est au QD et je ne croise aucune fille. En plus, si je ne m’abuse, la loi interdit les fouilles systématiques non justifiées. J’avais, par apaisement, accepté le passage à la « poêle » électronique au retour de promenade jusqu’à la veille (négociée par une fouille à nue à la 1ère promenade, le vendredi). Il a gueulé « palpation ou rien ! » et est parti en disant que je n’aurais rien ce matin là. J’essaye d’avoir quelqu’un à l’interphone à partir de 11h pour la promenade, mais rien. Quand le chef de bâtiment m’apporte la gamelle, il me dit que je verrai le médecin vers 15h. Effectivement, il est là à 14h30. Mais il me dit « Je vais vous examiner dans une salle spécifique, mais des surveillants resteront avec nous ». Je lui réponds très poliment que c’est impossible, que ce sont eux qui m’ont agressée, qu’il doit me faire confiance, que je ne l’agresserai pas et qu’il a dit le serment d’Hippocrate. Il discute 5min, puis part (« Je vous laisse réfléchir »). Je l’appelle, en pleurs, mais il ne revient pas. Plusieurs fois dans l’après-midi, je demande à la surveillante à l’interphone de m’écouter, de trouver une solution. Ça fait 36h que je suis dans la cage, presque nue car les vêtements ont été mouillés et salis lors de la contention. Malgré la loi, ils me privent de douche, de promenade et visite médicale. Quand le chef amène la gamelle à 18h30, je suis au 36ème dessous, dégoûtée par le mépris. Il fait semblant de discuter mais c’est juste pour que je lui remette le lacet qu’ils m’ont laissé la veille avec une chaussure et ma boîte d’allumettes. Je me calme grâce au courrier des copains, reçu de l’alpage et remets mon projet de feu (j’avais planqué des allumettes et un grattoir dès le 1er soir). […]
Le jeudi matin, à 7h, […] je retente de demander calmement un médiateur (la chef de détention par ex), mais on me dit juste que la chef viendra plus tard (pour le repas donc). Ça fait 3 jours que je parle très calme (sauf la crise de pleurs mercredi soir, mais où je n’ai insulté personne), que j’essaye de trouver des solutions, et ils me font tricarde. Je n’ai plus le choix : malgré les conseils des copains, je dois me faire blesser pour avoir enfin un toubib et lui expliquer. Je fous donc le feu aux barquettes en plastiques de quatre repas précédents, sans que ça ne représente un danger pour mes codétenues et leurs bébés. Bien sûr, ils arrivent équipés pour me foutre dans le mitard d’à côté. Malgré les coups de poings (ça doit être le protocole ici !), l’arcade tiens bon : et merde ! Mes vêtements sont mouillés par l’extincteur et la cellule complètement vide sauf le matelas. Je demande mes affaires à l’interphone qu’ils raccrochent immédiatement. À midi et ½, c’est la chef de détention, que j’accueille nue. Elle n’a aucune affaire pour moi. Je sais qu’il peuvent me faire tricarde comme ça jusqu’au 17 août, la date de fin de sanction décidée à Bapaume. Pour accélérer, il faut donc se mettre en grève de la faim. J’y ajoute une grève de la parole puisque, quoi que je dise, quel que soit le ton, je ne suis pas entendue. […] Le toubib et une responsable SMPR [3] sont venus me voir vers 17h, alors que je ne les espérais plus. Comme le chef le matin, ils m’expliquent qu’ils n’y peuvent rien, que c’est l’AP qui décide. Je leur réponds par petits papiers que c’est des menteurs puis mets fin à ce faux entretien à travers la grille. C’est toujours le même chef à 18h30, qui se pointe pour que je refuse la gamelle, il aimerait que je lui parle mais me refuse mon tabac. Par contre, j’ai enfin le reste de mon paquetage resté au mitard à Bapaume.
[…] Je sais que je ne verrai rien ni personne cet après-midi. Et que ça sera pareil demain. Sauf que ça fera 3 jours que je refuse la gamelle et qu’ils devront prévenir la DI [Direction Inter-régionale de l’AP].
La revendication posée pour l’arrêt de la grève (de la parole et de la faim) c’est que je puisse discuter, dans l’ordre où ils veulent avec :
mon avocate par téléphone
un médecin dans des conditions de consultation
un représentant de la direction, quel-qu’il soit et même à travers la grille
Je sais par une amie [4] qu’une grève de la faim peut durer 2 semaines avant qu’on soit abîmée et je tiendrai.
À moins qu’ils me collent au QI comme à Joux, il faudra qu’ils lâchent le 17 août quand je serai de retour en bâtiment et en promenade collective. Ça va être long… !
Salut ! Y Viva la Lucha !
SEQUEDIN,
samedi 10 août
Ma situation s’est débloquée jeudi vers 16h. Immédiatement, j’ai mangé le plat de lentilles mis de côté (j’avais de l’espoir) à la gamelle de midi. J’avais repris à parler depuis mardi 14h, aux premiers prémices.
Voilà ce qui s’est passé :
[…] Mardi,5ème jour de la grève, même si le chef du jour (le chef de bâtiment) est un peu moins con que la brigarde du WE, je n’ai ni promenade ni téléphone. Mais il me passe mon guide de l’OIP et j’ai la référence des textes qui interdisent la fouille systématique et je lui fais passer.
À 17h30, je vois le big boss (il paraît que c’est exceptionnel qu’il voie un taulard) et la chef de détention des premiers jours, Sylvie. Il me dit que je verrai dorénavant les médecins correctement (s’ils le demandent) et que, puisqu’on n’est pas d’accord sur l’interprétation de la loi et que je ne dispose que d’un livre « fait par des crétins qui n’y connaissent rien », il va me faire passer demain les textes en question. En signe d’apaisement, Sylvie me file deux clopes à elle et me les regarde fumer en discutant calmement. Elle m’en laisse aussi une pour le lendemain matin. Moi, je lui donne deux allumettes coincées dans la poche depuis jeudi (elles ne me servent à rien, je n’ai pas de grattoir). J’ai aussi des livres de la biblio demandés depuis lundi matin.
À 17h, le mercredi, c’est le chef de bâtiment. Il m’allume bloqué sur sa putain de palpation. Toute la matinée, j’attends les papiers promis par le dirlo en trépignant. À 10h, la même toubib pétocharde qu’hier vient, mais n’ouvre pas la grille car elle n’aurait pas encore reçu la consigne . À 11h30, il amènent au mitard une fille en lui faisant mal, elle est dans le même état que K. et on ne peut pas discuter. À midi la toubib revient et ouvre la grille. Cette pétocharde s’est faite accompagner par un infirmier SMPR bien costaud, mais le rendez-vous est correctement fait. « Mais on ne vous connait pas… », « Ben justement ! ». Je les envoie chez la voisine qui hurle qu’elle a mal.
[…]À 16h, le directeur vient enfin avec les papiers. Je lui demande de revenir dans une heure quand je les aurai étudiés. Il me dit qu’il est dans les clous puisque les fouilles à chaque sortie de cellule des 900 personnes enfermées ici sont justifiées par le risque de trafic J’aurais aimé manger ce soir, mais je veux pouvoir étudier les textes sans le laisser mentir. Il dit qu’il reviendra demain (il paraît que c’est encore plus exceptionnel 3RDV comme ça en 3 jours , je suis VIP !), je lui demande de venir le matin (pour manger à midi), mais il reste le Big Boss et me dit « je viendrai quand j’aurai le temps ».
Jeudi, […] le dirlo arrive à 15h30. J’avais préparé mon exposé, comme une bonne élève. La seule chose que je sens qui fait mouche c’est quand je fais, sur le ton de la confidence psy, le parallèle entre palpation et viol, puis viol et autorité et que j’explique en quoi la fouille à nue (sans contact et où les deux parties sont mal à l’aise) est moins humiliante. Il se retire avec Sylvie et reviennent 5 min plus tard me dire que je peux aller au tel. Je n’ai aucune fouille, il n’y a que la chef de détention et le chef de bâtiment de visibles. J’appelle non seulement mon avocate, en lui demandant une visite, mais aussi mes parents pour les rassurer. Puis je vais en promenade. Assise torse nu au soleil, je savoure la barquette de lentilles ! Ils m’ont aussi donné des allumettes, avec le protocole que je leur ai expliqué (une boîte avec un chiffre donné, puis comptage au retour des brûlées et des soufrées).De retour en cellule, j’ai la barquette. Ça y est, c’est calmé !
À la gamelle, le chef me demande si je suis contente. Je lui explique que je n’ai pas à être contente d’en avoir tant chié pour que la justice règne enfin. Il me dit que j’ai eu raison de parler du tripotage et de ce que j’en ressentais, je lui réponds que c’est un discours de voyeur malsain. Il ne comprend pas pourquoi on n’est pas potes… Moi je mange la moitié de la gamelle et m’endors le ventre plein dès 19h30. Ouf !
[…] L’essentiel pour moi est gagné : visite du médecin en vis à vis et pas de tripotage . […] J’ai appris aujourd’hui que le dirlo avait pondu une note à mon sujet disant :
pas d’ouverture de la porte (je dis bien la porte pas la grille !) sans un(e) brigard(e)
fouille électronique sans contact, mais face au mur
effectif renforcé lors des promenades : au moins 1 brigard et 6 en tout
une seule promenade par jour
contrôle œilleton toutes les heures en journée et quatre fois par nuit
Je ne sais pas comment ils comptent revenir à la normale en une semaine… Soit ils y arrivent et tant mieux, j’irai en bâtiment. Soit ils vont me coller au QI sans raison ces salopards…
SEQUEDIN,
mardi 20 août
Je suis sortie du mitard ce WE. Pas originaux, ils m’ont collé direct au QI, comme à Joux.
Ils ont justifié ça par le dossier disciplinaire, ce QI n’est pas valable. En vrai, ils ne veulent pas que j’aille en bâtiment où les filles (et les mecs aussi d’ailleurs) se font tripoter avant chaque promenade. Ils savent que je refuserai la palpation et n’ont pas envie de me cogner dessus à 10 contre un devant les filles qui pourraient être choquées et du coup (oh horreur !) solidaires.
[…] Hier, lundi, [ma voisine de QD] passait au prétoire. Moi j’étais dans la salle où il y a le téléphone, à une dizaine de mètres. J’ai entendu qu’ils la rentraient de force, elle criait qu’elle avait mal. Forte de l’expérience passée et de la promesse du psy, elle pensait que ça s’arrêterait là, mais ils lui ont mis 30 jours ! Devant leur violence (4 matonnes étaient arrivées en courant au QD en plus), j’ai cogné sur la porte de la salle. Bizarrement, en quatre coups de pied, j’ai fait péter la serrure et me suis retrouvée dans le couloir qui donne d’un côté sur le QD de l’autre sur le QI et de l’autre sur la rotonde et l’accès à la grande promenade. Je suis allée vers le QD, il y avait 6 matonnes derrière la porte, dont la directrice. Une brigade moins conne que la moyenne m’a dit : « Je t’assure qu’on ne l’a pas cognée, je ne l’ai même pas menottée. Là, le psychiatre va venir. Mais toi, on a jamais vu ça et l’alarme a été déclenchée. Regarde les gars arrivent. Couche-toi au sol c’est le mieux ». J’ai plutôt confiance en elle et je l’ai crue. Je me suis retournée vers l’autre bout du couloir. À 20m, derrière la grille, il y avait 5 mecs. Je leur ai crié : « Qu’est ce que vous voulez ? ». Il m’ont dit « Rentre dans la pièce » et je suis retournée calmement dans la salle de téléphone. J’y suis restée presque une minute à les attendre. Je les entendais, de plus en plus nombreux. Je suis ressortie en leur disant « Vous attendez les casqués ? Y’a pas besoin… ». Ils étaient plus de 20. La chef de détention, Sylvie, a traversé leur groupe et a franchi la grille en leur disant de rester derrière. Elle est venue seule vers moi et m’a demandé ce qui se passait. Je lui ai répondu en une phrase et l’ai tout de suite suivie pour qu’elle me mette en cellule. […]
Mercredi 21, 7h : Bon c’est l’équipe de jour qui va prendre le relais. Cette nuit, ils n’ont rien voulu comprendre. À minuit et ½, ils ont tapé sur la porte au point de réveiller la voisine. Trois fois, ils sont venus à au moins 5 pour me foutre la lampe torche dans les yeux. Mais ce n’est pas allé à l’affrontement.
Bah, du coup, j’ai bien eu le temps d’observer les rats (très nombreux) qui baladent sous la fenêtre, tant la nuit que le jour. 100 % des fenêtres de la MAF sont fermées par un grillage, soit disant pour qu’on ne les nourrisse pas, mais ça ne change rien. Moi, en tant que rurale, ça ne me gène pas du tout, au contraire : je vois du vivant sans uniforme ! J’aimerais bien essayer d’en apprivoiser un…
Je raconterai ça plus tard…
À la prochaine
Christine
Notes
[1] FIES ( Fichier des Internes en Suivi Spécial) : À la fin des années 70, de nombreuses luttes de taulards secouent les prisons Espagnoles. Suites à celà l’État instaure des régimes spéciaux pour permettre notamment l’isolement et la surveillance des détenus jugés dangereux. De là naissent les FIES, institutionnalisés en 1991.
Voir notamment ici : http://toutmondehors.free.fr/fies.html
[2] Mickael Bocquet est un des matons de Bapaume qui, après avoir étranglé et cogné Christine, avaient portés plainte contre elle. Il s’est constitué partie civile pour le procès du 19 septembre.
[3] SMPR (Service Médico Psychiatrique Régional) : quartier psy à l’intérieur des prisons. Différent des UHSA (Unités Hospitalières Spécialement Aménagées) qui sont des prisons/HP à part entière installées sur des sites hospitaliers.
[4] Le 5 juillet, à Bapaume, pour avoir persisté à manger leur gamelle en promenade, Christine et une amie codétenue se voient poser un ultimatum par l’AP. Soit elles acceptent de réintégrer leur cellules en régime « porte fermée » jusqu’à nouvel ordre, soit elles partent au mitard. Christine part au mitard. Son amie se retrouve en régime porte fermée. Pour protester contre ce régime et la mise au mitard de Christine, elle entame une grève de la faim qui durera 15 jours. Elle obtient finalement un entretien avec le dirlo de Bapaume et accepte de se réalimenter. Pour en lire plus voir ici : http://cestdejatoutdesuite.noblogs.org/2013/07/09/renvoi-lors-du-proces-de-christine-a-arras-du-mitard-de-nouveau/